Actes du Colloque international organisé par la Faculté d’Études françaises et francophones de l’Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU) le 29 mai 2021
Sous la direction de DAI Dongmei et Roland SCHEIFF
En collaboration avec FU Rong, Michael SCHAUB, SHAO Nan
Louvain-la-Neuve : Éditions Academia, 2022
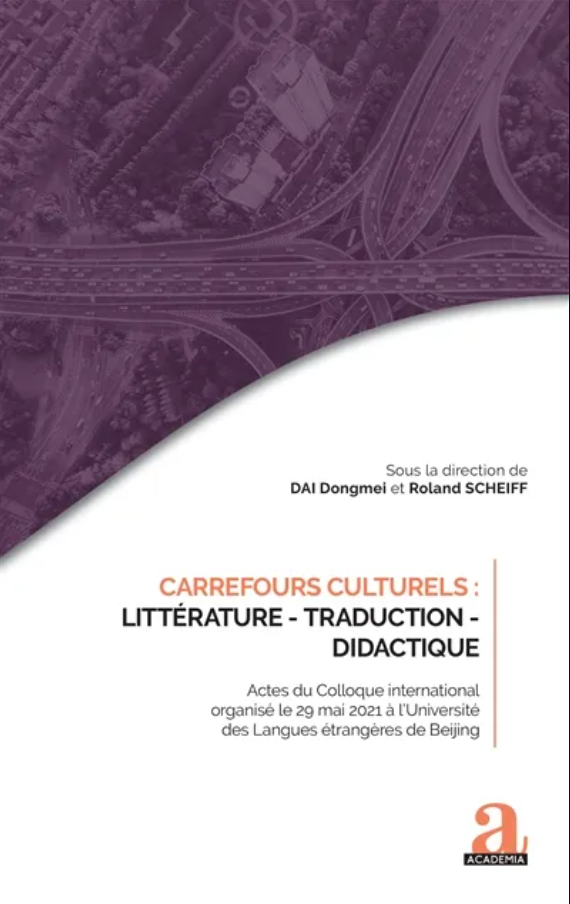
La construction d’un Moi à travers un Autre : l’Europe selon André Gide
YU Nan (Université du Hebei)
Résumé : Le contexte de tension franco-allemande de l’entre-deux-guerres suscite parmi les intellectuels européens un débat concernant l’identité européenne. Pour apaiser les discours tant vindicatifs que sceptiques sur une entente possible des deux pays, André Gide rédige un article en répondant à une enquête portant sur l’avenir de l’Europe. La réponse de Gide se construit essentiellement autour d’une conversation avec un Chinois érudit anonyme où l’écrivain français tente de regarder l’Europe avec les yeux de ce Chinois afin de proposer une identité européenne qui puisse réconcilier la France et l’Allemagne. Cette réponse sur l’Europe révèle en même temps l’imaginaire de Gide sur la Chine : civilisation à la fois lointaine et similaire qui cherche un nouvel équilibre entre la tradition et la modernité.
Mots clés : littérature comparée, André Gide, identité européenne, image de la Chine
« Péril blanc » réel contre « péril jaune » imaginaire, Anatole France et les évène[1]ments d’Extrême-Orient
Laurent BROCHE (Université du Zhejiang)
Résumé : En 1905, Anatole France publie Sur la pierre blanche. Dans le chapitre IV, Langelier délivre une forte charge contre le colonialisme, l’expansionnisme européen en Asie et la croyance au péril jaune. L’article retrace les emprunts faits par le romancier – qui les oriente vers moins de racialisme – aux arguments développée par le journaliste Finot contre le physiologiste Charles Richet, tenant de la supériorité de la race blanche, de l’infériorité des races noire et jaune et du péril jaune. Rapproché d’articles et autres interventions du romancier, le personnage de Langelier s’avère le porte-parole fictionnel d’Anatole France. Comme des journalistes et essayistes de son temps, le romancier oppose le caractère imaginaire du péril jaune aux réalités brutales du péril blanc. Cette prise de position le distingue fortement de la plus grande partie des écrivains d’alors.
Mots clés : anti-colonialisme ; péril jaune ; péril blanc
Intersubjectivité dans l’écriture sarrautienne – Soi-même comme un Autre
WANG Xiaoxia (Institut de Diplomatie de Chine)
Résumé : Toute l’œuvre de Nathalie Sarraute vise à construire une relation interactancielle et fusionnelle entre « moi » et « autrui » à travers une écriture en dialogue ou en sub-dialogue – une écriture intersubjective à trois niveaux : l’intersubjectivité entre le narrateur et le narrataire ; l’intersubjectivité entre les personnages ; l’intersubjectivité entre l’auteure et elle-même. Pour l’écrivaine, « L’Autre est toujours l’élément fondateur qui met en branle la dynamique du moi. Je ne suis que dans la mesure où je suis en relation, où autrui en face de moi est ce catalyseur qui me pousse à me définir ». Cette écriture intersubjective pourrait en effet s’expliquer par la compréhension subtile de l’auteure sur la relation entre « moi » et « autrui » : « moi » existe par rapport à l’« Autre », le « fond commun » de l’être humain lui fait voir « soi-même » comme un « Autre ».
Mots clés : dialogue, intersubjectivité, soi-même, autre
Jacques Roubaud : sémantisme spatial de l’Extrême-Orient
Charlène CLONTS (Kyushu Université)
Résumé : Le recueil Tridents de Jacques Roubaud se fonde sur des procédés liés à l’interculturalité (plurilinguisme, intertextualité, formes) tout en créant de nouveaux espaces littéraires. Son rapport aux cultures de l’ExtrêmeOrient (littératures, sagesses, images), en particulier à la culture japonaise, et l’attraction qu’elles suscitent permettent de souligner la matérialité de l’écriture. La mise en regard de cultures de l’idéogramme ouvre le recueil sur un espace où le visible et le lisible s’entremêlent différemment. La spatialisation des tridents de Roubaud est issue d’une conception géopoétique de l’écriture puisqu’elle fait émerger un dialogue complexe entre la poésie de langue française et celle des anthologies impériales japonaises, ellemême en dialogue constant avec la poésie de la Chine ancienne. Cette interculturalité s’exprime notamment dans les références linguistiques, littéraires et artistiques ; elle devient transculturalité au travers de l’espace tangible du recueil par le blanchiment de la page, par la spatialité et par les emplois divers de la ponctuation. L’une et l’autre indiquent aussi une pratique poétique symptomatique d’une aspiration à la disposition et à l’agencement matériel et référentiel. Ces carrefours culturels et sémiotiques permettent en retour la mise en branle d’un voir fécond : le recueil produit une circulation qui est aussi une trahison créatrice.
Mots clés : poésie contemporaine de langue française, matérialité poétique, idéogramme, poésie japonaise, interculturalité, transculturalité, mathématiques
Métamorphose de l’image du labyrinthe : de Maurice Maeterlinck à Victor Segalen
SHAO Nan (Université des Langues étrangères de Beijing)
Résumé : Comme Gaston Bachelard le montre, le labyrinthe est source d’angoisse en ce qu’il rappelle une peur ancestrale : se perdre dans la forêt. En affirmant cela, Bachelard ignore pourtant qu’en Chine, une telle angoisse, s’il y en a eu, a longuement été estompée par une expérience esthétique dans les actes de « perdre » et de « se perdre ». En effet, en confrontant des images du labyrinthe de Maurice Maeterlinck et celles de Victor Segalen, nous avons constaté une surprenante rencontre des deux traditions. Les images du labyrinthe abondantes chez Maeterlinck portent surtout l’ombre inquiétant d’un « moi » inconnu et inconnaissable, là où Segalen, lecteur de Maeterlinck, ayant emprunté de ce dernier l’image du labyrinthe, s’est imprégné ensuite de la culture chinoise et surtout du taoïsme, de sorte que sa vision du labyrinthe a connu des changements considérables.
Cette métamorphose de l’image du labyrinthe n’est pas simplement littéraire. Des châteaux occidentaux aux jardins chinois, de l’angoisse à l’ivresse, de la valeur psychique à la valeur esthétique, cette métamorphose implique de nouvelles façons de voir le monde, ainsi que de considérer la relation entre le « Moi » et l’« Autre ».
Mots clés : Maurice Maeterlinck, Victor Segalen, labyrinthe, château, jardins chinois
Image et imagologie : quelques réflexions conceptuelles et méthodologiques
Michael SCHAUB (Wallonie-Bruxelles International)
Résumé : Cet article a pour objectif d’esquisser des propositions de renouvellement des concepts et méthodes de l’imagologie en regard des travaux récents en Europe et en tenant compte des évolutions dans les domaines des Études culturelles et de l’analyse du discours. Il apparaît en effet que l’imagologie est un domaine actuellement peu investi dans les pays francophones par rapport à d’autres pays européens, alors que de nombreux travaux contemporains s’inscrivent pourtant dans son objet de recherche que sont les représentations de l’altérité.
Mots clés : imagologie, discours, stéréotype, imaginaire, altérité
Fleur · Intelligence Aperçu de l’influence littéraire de Maeterlinck sur Steichen, pionnier du Bio-art
TANG Kun (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Résumé : L’artiste américain Edward Steichen (1879-1973) est surtout connu pour ses photographies, mais sa véritable passion réside danssa « carrière horticole » à laquelle il a consacré toute sa vie. Steichen aimait les fleurs. Il a commencé très jeune à pratiquer la culture sélective, et a proposé ensuite la forme de l’art de la culture sélective des fleurs qui restera inscrite pour toujours dans l’histoire de l’art. Les fortes corrélations entre cet aspect de son travail et les œuvres – dont L’Intelligence des fleurs (1907) –du dramaturge et poète belge, Maurice Maeterlinck (1862-1949), sont les principales questions qui sont traitées dans cet article. Nous avons clarifié les indices de ces questions sous les trois aspects suivants : l’origine de l’art de la sélection florale, la contemplation des situations humaines et la recherche de l’esprit de la nature.
Mots clés : intelligence des fleurs, art de la sélection florale, destin, esprit de la nature, mystères de la Vie
« Des Russes en Belgique » : une rétrospective de la présence du Groupe des Cinq dans le paysage musical belge entre 1885 et 1912
Roland SCHEIFF (Université des Langues étrangères de Beijing)
Résumé : Traditionnellement présentée comme un des premiers pays d’Europe occidentale à accueillir le Groupe des Cinq, la Belgique entend en 1885 la musique de ce nouveau cénacle russe introduite par l’entremise de la comtesse Mercy-Argenteau. Décrite comme un feu de paille de quelques années tout au plus, cette incursion musicale russe en terre belge est souvent présentée comme n’ayant exercée aucune influence durable. La presse artistique et littéraire belge de l’époque concernée tend cependant à nuancer cette affirmation. Non seulement ces compositeurs russes restent à l’affiche de concerts programmés en Belgique jusqu’en 1912 mais ils font en outre l’objet de toute une série d’articles, parus dans cette même presse belge, qui tentent d’en donner les principales caractéristiques sur le plan musical tout en revenant sur leur parcours en Belgique.
L’article vise à reposer la question de la réception de ces musiciens russes en Belgique à l’aide de la presse artistique et littéraire belge de cette époque. Tout d’abord perçus comme totalement étrangers à la scène musicale belge, ces compositeurs russes seront petit à petit mieux appréhendés par la critique artistique qui finira par se familiariser avec leurs œuvres au point de les intégrer dans ses réflexions et discours musicaux.
Mots clés : musicologie, Belgique, réception musicale, Groupe des Cinq, XIXe siècle
L’expérience de l’altérité chez Tristan Tzara
Fatma BELHEDI (Université de Tunis)
Résumé : L’œuvre de Tristan Tzara est aussi complexe qu’insaisissable. En poète, écrivain, critique et collectionneur d’arts dits primitifs, il a longtemps réfléchi sur le potentiel de la poésie, inscrivant celle-ci dans l’entreprise plus large d’une révolution totale de la vie et du monde. Au centre de ces préoccupations : l’Homme et son indéniable potentiel. Dans ses deux recueils majeurs L’Antitête et L’Homme approximatif, Tzara sonde et explore, dans l’intimité de l’œuvre, ce qui fonde l’humanité, s’engageant, par une écriture intempestive, dans une expérience de l’altérité où les limites entre l’Homme et la nature s’effacent au détriment du bon sens et de la bienséance.
Mots clés : Tristan Tzara, poésie, avant-garde, identité, altérité
Littérature(s) francophone(s) en FLE, du soi à l’Autre
Patricia GARDIES (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
Résumé : Pour Ladmiral et Lipiansky (1989 : 309) tout individu est amené « à prendre conscience que même ses réactions les plus intimes et les plus affectives sont structurées par un imaginaire social347 ». C’est à la lumière de ce raisonnement que peutse créer la rencontre interculturelle. La prise de conscience de notre vision filtrée du monde permet d’appréhender différemment l’altérité, d’aborder la diversité des codes culturels, d’identifier les référents (le monde), de percevoir les schèmes de communications différents. Introduire dans la didactique de la littérature et plus spécifiquement dans l’apprentissage de la littérature francophone, une démarche de regards croisés permet l’interconnexion des univers favorisant ainsi la rencontre de l’Autre.
Appréhender les littératures francophones permet de participer à la construction d’une identité plurilingue grâce à la découverte d’univers singuliers, de nouvelles connaissances ethnographiques et s’associer ainsi à de nouveaux imaginaires partagés. Il est agréable de sentir l’odeur du café des Palmes348 dans l’univers haïtien de Dany Laferrière, de découvrir le griot Diamourou dans le souffle de l’harmattan chez Ahmadou Kourouma349, sourire devant l’étonnement d’Akira Mizubayashi350 face aux niveaux de langue du français, « Le dimanche pour bouffer, il faut se démerder les restos U sont fermés ! », autant de rencontres interculturelles et de points de convergence entre diverses disciplines.
Mots clés : littérature francophone, interculturel, altérité, représentations interculturelles
La traduction et la réception en France de la littérature chinoise du Xxe siècle : lignes et tournants
Angel PINO (Université Bordeaux Montaigne)
Résumé : Les premiers à s’être intéressés à la littérature chinoise du XXe siècle, furent des missionnaires français ou belges installés en Chine. Encore était-ce pour des raisons extra-littéraires : ces derniers se donnaient avant tout pour but de guider les âmes chinoises dans leurs lectures. En revanche, eux-mêmes ne se livrèrent que très peu à la traduction.
Après la fondation de la R.P.C. et jusqu’à la mort de Mao Zedong, ce sont toujours des raisons extralittéraires, en l’espèce des raisons politiques, qui expliquent la curiosité portée en France à la littérature chinoise moderne. Les premières œuvres romanesques traduites du chinois parurent ainsi chez des éditeurs appartenant à la galaxie du Parti communiste français, ou bien aux Éditions en Langues étrangères de Beijing, et elles furent diffusées via des réseaux militants, comme l’Association des amitiés franco-chinoises.
Au début de la « période de réforme et d’ouverture » de la Chine, ce sont encore des raisons extra-littéraires qui vont présider à la traduction et à l’édition de la littérature chinoise. Cette fois, ce ne sont plus les laudateurs de la Chine qui vont s’activer mais plutôt ses détracteurs, lesquels privilégieront les œuvres littéraires à vocation documentaire. Assez vite, néanmoins, une nouvelle génération de spécialistes prendra le relais : des sinologues versés aussi bien dans les études sur la littérature chinoise du XXe siècle que dans la traduction des œuvres, et dans une optique désormais résolument littéraire.
Mots clés : traduction, réception, histoire littéraire
Pratiquement faisable Un bilan de la traduction de l’OuLiPo en Chine (1981-2022)
XIA Yuhua (INALCO)
Résumé : Créé en 1960 par François Le Lionnais et Raymond Queneau en France, l’OuLiPo vient de fêter son soixantième anniversaire. Ce groupe littéraire a pour mission de découvrir et de développer des « contraintes » en littérature, de sorte que ses ouvrages sont couramment qualifiés d’intraduisibles. Cependant, à compter d’une première traduction d’Italo Calvino publiée en volume dans la partie continentale de la Chine en 1981, des auteurs oulipiens sont traduits en chinois depuis au moins une quarantaine d’années, des œuvres connues pour leur intraduisibilité, telles que La Vie mode d’emploi de Georges Perec et Exercices de style de Raymond Queneau, ont aussi été traduites. Cette odyssée rendant possible l’impossible n’est pas seulement une aventure de traducteurs, mais également une histoire de l’édition chinoise contemporaine.
Mots clés : OuLiPo, traduction, édition, marché du livre, légitimité
Au carrefour de l’histoire : traduire et retraduire la guerre dans Retour à Tipasa d’Albert Camus
Pauline MARTOS (Université Toulouse II Jean Jaurès)
Résumé : Albert Camus a écrit de manière prolifique au sujet des combats de la deuxième guerre mondiale, dont il a été un témoin privilégié en sa qualité de résistant. Retour à Tipasa est l’occasion pour l’auteur de revenir sur ses souvenirs de guerre. On observe des divergences significatives entre le texte, sa première et sa seconde traduction aux États-Unis. Alors que la deuxième traduction s’en tient plus strictement à ce que décrit Camus au sujet de la guerre, notamment pour ce qui est du traitement du corps, le premier traducteur mêle son propre témoignage de guerre au texte de Camus, l’ayant vécu lui-même, et intensifie une lumière omniprésente dans le texte original, maximisant ainsi le potentiel du texte.
Mots clés : guerre, traduction, retraduction, Albert Camus
Les spectacles chinois (opéra, théâtre, acrobatie, cirque) dans la presse française : écueils ethnocentriques et enjeux de traduction
Éléonore MARTIN (Université Bordeaux Montaigne)
Résumé : Cet article propose une exploration de la représentation et de la réception des spectacles chi[1]nois (opéra, théâtre, cirque, acrobatie) dans la presse française des XIXe et XXe siècles, aussi bien la presse générale et quotidienne que les revues spécialisées et les hebdomadaires d’actualité. La traduction française de ces formes spectaculaires chinoises est problématique car il n’existe pas en France de spectacles équivalents en termes de pluridisciplinarité. On montrera l’évolution des traductions dans le temps, ce qu’elles disent de l’histoire de la perception des formes chinoises et les écueils ethnocentriques qu’elles véhiculent ou tentent de contourner.
Mots clés : spectacles chinois, intraduisible, réception, presse française, ethnocentrisme
La mobilisation de l’imaginaire linguistique et des représentations identitaires dans l’écriture d’invention : l’ailleurs, l’autre et soi chez les apprenants universitaires chinois
Eva BLASI (Université du Yunnan)
Résumé : Ce mémoire de recherche soutenu auprès de l’université d’Angers en juin 2020 et intitulé « La mobilisation de l’imaginaire linguistique et des représentations identitaires dans l’écriture d’invention : l’ailleurs, l’autre et soi chez les apprenants universitaires chinois » s’intéresse à la fiction et à ses processus d’écriture auprès d’étudiants universitaires chinois de Master à l’Université du Yunnan. L’étude s’inscrit sur les recherches actuelles de la place de la fiction et des ateliers d’écriture créative. À partir de la littératie des apprenants chinois, comment l’écriture d’invention mobilise l’imaginaire linguistique et les représentations identitaires des apprenants chinois ? Cette question de recherche s’appuie sur un corpus constitué de trois œuvres fictionnelles (le conte, la nouvelle fantastique et le théâtre) favorisant l’émergence de la créativité et l’imagination, ainsi que sur quatre questionnaires réflexifs, révélant l’identité imaginaire translingue des apprenants chinois, voire leurs transidentités, à travers des processus créatifs distincts.
Mots clés : fiction, imaginaire, représentations, identité scripturale
Découverte de l’Autre et construction de Soi : l’interculturalité dans l’enseignement de la littérature en classe de FLE
HE Xin (Université des Langues étrangères de Beijing)
Résumé : L’enseignement de la littérature devrait occuper de nos jours une place importante dans la classe du français langue étrangère. Depuis quelques années, nous nous y intéressons surtout dans le cadre d’une approche interculturelle qui pourrait dynamiser la rencontre des mentalités et favoriser la construction de Soi par la découverte de l’Autre. Enseigner la littérature française dans ce cadre demande donc à prendre en compte la propre culture de l’apprenant et à établir une connivence culturelle, dans l’objectif de réduire au maximum le « choc culturel » et d’éviter des malentendus, des interprétations erronées et des contresens dans la réception d’un texte littéraire. Loin d’être un facteur d’acculturation ou de renoncement à son identité culturelle, une pratique interculturelle de la littérature, qui se double d’une démarche comparatiste, pourrait guider l’apprenant vers un réexamen et une redécouverte de sa propre culture, voire une construction de sa propre identité culturelle.
Mots clés : didactique en littérature, classe de FLE, approche interculturelle, construction de Soi
Une hiérarchisation des traits morphologiques des pronoms personnels du français
Xiaoliang HUANG (Université des Langues étrangères de Beijing)
Résumé : Cet article est une tentative qui combine formalisme et quelques réflexions de l’ordre de la linguistique générale pour déchiffrer le syncrétisme des pronoms personnels du français. Au travers d’un mappage de traits morphologiques, une hiérarchie dans leur réalisation sera mise au jour. Un examen plus approfondi de cette hiérarchie sous l’angle de la notion de la « personne » et de la « non-personne » montrera que le marquage morphologique des pronoms est en proportion inverse de leur référentialité.
Mots clés : hiérarchie, français, pronoms personnels, référentialité, traits morphologiques